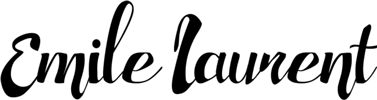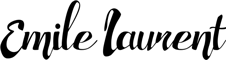Amertume
Le malheur et la peine
Sont-ils à ce point contagieux ?
Pour qu’on puisse sans haine
Nous laisser en baissant les yeux !
Oui … les amis de porcelaine
A petits pas feutrés … sans bruit
S’en sont allés en bas de laine
Dans le silence de la nuit.
Ainsi s’estompe l’amitié vaine
Sur les chemins de l’oubli
Cela ajoute-t-il à la peine ?
Non … c’est rançon à la vie … pardi !
La maison de ma mère.
Conte sociologique.
Ma mère avait les cheveux blancs lorsque sur le tard, j’héritai de la maison.
J’ai septante ans, je n’ai pas vu passer le temps. Je crois devoir écrire un préambule pour la compréhension de ce récit singulier qui débute sur un coup de fil inattendu…
– Allo…, Monsieur Jean Piret ?
– Lui-même… à qui ai-je l’honneur ?
– A une très vieille connaissance…. L’annuaire… ton numéro de téléphone et … voila … une envie tant de fois réprimée de te parler.
– Je ne vois pas … Madame !
– Mais si, rappelles-toi … Odile … Odile Vandeven … que c’est loin l’adolescence ! … Peut-être pourrions nous nous revoir ….
Ce coup de fil vient de rouvrir une parenthèse que je croyais fermée sur un moment de ma prime enfance.
Je suis curieusement irrité d’avoir si promptement répondu à cette invitation de rendez-vous. Je me souviens très bien d’Odile et de cette époque … que les moins de ….
En ce temps là, nous habitions un coron ouvrier. Les maisons modestes étaient plantées entre hauts fourneaux et charbonnages. Au début du mois, Monsieur Joseph, un affreux petit bonhomme roux, venait toucher le loyer pour le compte de la Société des Charbonnages de Sacré-Madame. Les voisins, tout comme nous, payaient la dîme avec amertume. A la maison proche, les Vandeven étaient des gens bien sympathiques. A l’époque, j’avais près de huit ans, j’étais fils unique, je jouais avec Odile, j’en étais très heureux.
Un beau jour, une idée étonnante germa dans l’esprit de ma mère, femme douce mais très énergique, la folle idée de devenir propriétaire de notre maison.
Après maints palabres, mon père se laissa convaincre, il léga, à ma mère, la tâche de régler des démarches inhérentes à une éventuelle opération d’achat.
Ma mère remua ciel et terre. De la Société des Charbonnages, elle obtint une promesse de vente, elle trouva une possibilité de prêt auprès de je ne sais quel organisme, dénicha un notaire et sortit triomphante de ce parcours du combattant.
Cela se passait en 1928, la vente fut conclue à 25.000 francs frais compris. Mon père acheta une bonne bouteille et nous bûmes …. du vin.
Je me souviens que ma m ère, bien souvent, en me câlinant me racontait qu’elle avait fait ça pour moi et que plus tard, ça me viendrait bien à point.
Les premiers du mois, Monsieur Joseph n’entra plus chez nous et …. Aux yeux des voisins nous étions devenus différents. Les rapports n’étaient plus les mêmes. Notre entourage semblait mal concevoir cette simple notion de propriété.
Pour mes parents, le plus dur se pointa à l’horizon. Les Vandeven et Odile déménagèrent sans un mot vers le haut de la Docherie en me laissant désemparé. Ma mère repris du service au Triqge du charbonnage. Mon père continua son dur métier de lamineur aux Forges de la Providence en passant de plus en plus souvent à la cantine. Mes grands parents me prirent en charge pour la journée et le soir, je rentrais à la maison.
Je passai une enfance sans problème mais pour mes parents, la crise industrielle des années 30 n’arrangea rien et au contraire la grève de 32 amplifia leurs difficultés financières.
A la fin de ma scolarité primaire, j’écrivis comme un petit homme à la Province au « Fond des mieux Doués » afin d’obtenir une bourse d’études qui ne vint pas. Je pris alors le chemin de l’Ecole industrielle à Charleroi avec aux fesses mon premier pantalon long.
Un jour, … et pour la deuxième fois … Odile réapparut dans ma vie. Nous nous rencontrâmes sur le haut de la Docherie. En souriant, elle vint à moi. Elle me dit fièrement qu’elle avait quatorze ans. J’en avais treize. Elle était rayonnante …. superbe.
L’adolescence a de ces émerveillements dont on sourit plus tard avec condescendance… Je planais, nous volions de rendez-vous furtifs en matinées au cinéma de quartier. Cela dura un court été … Et un dimanche, …. Ce fut le drame. Le père Vandeven nous surprit et siffla la fin de la récréation. Il réprimanda durement Odile et il eut à l’égard de ma famille des propos où il était question d’ambition, de prétention dont je ne compris le sens méprisant que plus tard. Je perdis définitivement Odile et une fois de plus ce fût la profonde affliction.
Mais …. la vie continue ! Le long fleuve pas si tranquille que ça, me happa comme tout commun mortel. J’appris le mariage précipité d’Odile et pour moi les années défilèrent à toute allure, parsemées de bonheurs et d’inévitables peines. J’ai septante ans, je suis veuf, je vis en toute quiétude dans la maison de ma mère. Je crois qu’à notre époque de la « Brique dans le ventre » il est assez difficile de comprendre l’ostracisme (oh ! le vilain mot) qui nous marqua ma famille et moi. La « Propriété » quelle banalité à l’heure présente.
Je me regarde dans le miroir, j’ai le cheveu rare, les traits durcis, je suis devenu un vieillard. Je pense à cette chère Odile qui a un an de plus que moi.
Je n’irai pas à ce rende-vous, où je ne pourrais que décevoir et être déçu. Je veux garder intact au fond de moi-même, le souvenir de cette fascinante période de mon adolescence et son complexe de sentiments si troublants que sont : pudeur et éveil des sens.
J’ai une pensée reconnaissante pour Odile qui elle non plus n’a pas pu oublier.
Une « Lapinade »
Je ne me rappelle plus l’origine du dicton « Il ne faut jamais dire fontaine je ne boirai plus de ton eau »
En attendant, sa plausibilité fut pour moi une sorte de capitulation affectée.
L’explication de mon expérience mérite quelques lignes car en plus, elle survint dans un cadre charmant de retrouvailles.
Ma femme et moi avions été conviés, par des amis de longue date, à partager le souper familial du jour de Noël.
Après quelques joyeuses considérations sur le temps qui passe et avec le champagne à l’apéritif, l’ambiance prit un tour agréable. Un superbe plateau carré en céramique blanche fit son apparition. Appelé dans un tour de table à garnir nos assiettes, le plateau était chargé en abondance de portions de boudins de couleurs et de compositions savantes : blancs bruns, noirs, corinthés, aux choux, à l’épinard et que sais-je encore, sinon que leur aspect appétissant nous mit l’eau aux papilles … ce repas démarra joyeusement.
Une petite pause : break arrosé et une chanson du terroir reprise en cœur, assurèrent l’euphorie de ce début de soirée.
Et, quand un peu plus tard, la maîtresse de maison amena avec une certaine difficulté l’énorme marmite qu’elle déposa au milieu de la table, il y eut un murmure de satisfaction car le contenu du récipient exhalait un parfum agréable et surprenant.
Damnation pour moi qui en était allergique depuis longtemps ! Cette marmite contenait une gibelotte de lapin aux pruneaux, agrémentée de condiments odoriférants judicieusement choisis. A ce moment, un ange passa et un toast fut porté à l’amitié.
Prétextant une raison futile, je ne me servi que parcimonieusement et j’encouru le regard sceptique de notre bonne hôtesse. Je débutai le plat en demi-teinte mais j’avoue humblement que « conquis » je fis honneur par la suite à une portion supplémentaire de ce fameux lapin et ce … après tant d’années de renonciation. Comme il reste chaud en ma mémoire le souvenir de ce merveilleux souper !
Il est curieux qu’on puisse garder une aversion pour une nourriture mal assimilée ou par l’écoeurement d’un dessert trop onctueux. Mon aversion à manger du lapin fut d’une autre nature et est loin d’être puérile en voici la vieille histoire qui date de mon enfance.
Les années « trente » furent des années noires, années de chômage, années très dures de crise pécuniaire.
Au coron du fond de Darmet, les habitants avaient heureusement, à portée de la main, les possibilités d’adoucir la misère ambiante : d’abord en résolvant en partie le gros problème de chauffage en glanant le charbon éparpillé dans les stérils déversés sur les terrils du Bierrau et des puits Parents. Cela exigeait toutefois une certaine dose de courage surtout par temps froid.
Bien sûr, fermons les yeux sur les inévitables chapardages sur la cour du charbonnage où certains acteurs malheureusement repérés furent traduits en justice et subirent des sanctions lamentables en ces temps si durs.
Une autre façon bien simple d’améliorer le quotidien avait pris pied dans bien des maisons du coron : l’élevage de lapins qui se faisait à peu de frais.
Chez mes grands parents, qui m’avait recueilli dans ma dixième année, le clapier avait pris place dans une petite remise et abritait les locataires aux longues oreilles.
Combien de fois n’ai-je ramené à la maison, le grand sac de jute bourré d’herbes folles destinées à nourrir les rongeurs encagés, appelés au triste destin de finir à la casserole ?
Mon grand père à l’écart dans la remise leur appliquait le fameux « coup du lapin » les dépiautait et les vidait.
Les disparitions de Bigoudi et Poil Blanc me rendirent malheureux. Rien que d’y penser, j’en avais la nausée. J’en mangeais du « bout des dents » car dixit ma grand-mère, « c’était ça ou rien d’autre »
Un jour de pluie, passant la tête dans l’ouverture supérieure de notre porte en deux parties, je fus témoin d’une scène abominable. Chez les voisins, les pattes ligaturées et suspendu à une pointe en fer fichée dans le mur, un lapin la tête en bas, se contorsionnait perdant son sang goutte à goutte par l’orbite d’un œil arraché.
En larmes, j’avisai ma grand-mère qui jeta un regard incrédule sur la triste scène. Elle referma la porte, me prit dans ses bras et me dit quelques mots … oubliés depuis. Mais mon grand père s’enquit de notre émoi et rouvrant la porte, il sortit brusquement en jurant. D’un coup de pied, il envoya à quelques mètres le vieux seau qui récoltait le sang de la bête, il dépendit le supplicié et mit fin à son calvaire en lui appliquant de la tranche de sa main le « coup du lapin », et il remit l’animal inerte au clou.
Le tintamarre provoqué par le déplacement du seau ameuta Packant le voisin, il apparut sur le seuil et hurla « De quoi je me mêle ? » Mon grand père le toisa de son mètre quatre vingt cinq et lui dit calmement ; « Fais ça proprement imbécile ! » et il rentra chez nous en silence.
De ce jour, mon grand père acquit à mes yeux de gamin une sorte d’aura que V. HUGO attribue à son père dans « Trait de générosité » Poème que je m’empressais de lire à l’école lorsqu’on pouvait choisir sa lecture à l’heure de français.
La « lapinade » est arrivée à son terme. Si l’atténuation de mon aversion au lapin ne doit rien à ce cher Freud, rendons cet honneur à une vieille et bonne amie qui eut le don de préparer avec succès cette mémorable gibelotte un jour de Noël.
À Fanny
Le 14 janvier 2009.
Le Camp des Ferrailleurs.
Il y a très longtemps, la rue de Marchienne, à présent obstruée, était le cordon ombilical reliant la commune de Dampremy à son fond de Darmet.
Elle avait l’aspect rébarbatif d’un tronçon pavé de Paris – Roubaix, avec en prime, une légère descente chaotique.
De nombreux ouvriers l’arpentaient, selon les pauses, de jour comme de nuit.
Aux heures de pointe, elle devenait (la belle image) les Champs Elysées du travail.
Au bas de la descente, elle frôlait le café « Pirou » et … après un tournant, elle débouchait sur un microcosme surprenant ; un cloaque de maisons ouvrières imbriquées le long du canal, à des arrières d’usines aux abords desquelles : le feu, l’eau, l’air pollué se livraient à des fantaisies diaboliques.
C’est dans les années trente que le fond de Darmet connut son apogée populaire grâce à deux sources d’intérêts ; une providentielle, les forges de la Providence, l’autre folklorique : le café « Pirou ».
Une occupation, un travail et surtout la rétribution escomptée, cela naît parfois de circonstances fortuites … Pour les ferrailleurs ce fût la proximité du crassier … la découverte d’un filon à revenus fluctuants … les mitrailles de fonte.
Le crassier se trouvait sur une ligne perpendiculaire et à courte distance d’une rangée de maisons : « la cour del pire ». L’appellation en wallon venait de l’énorme pierre, en forme d’évier, servant d’assise à la borne fontaine qui desservait la population en eau potable.
La cour comptait parmi ses habitants des marginaux plutôt sympathiques et un trio singulier les Strobans : Joachim, sa femme Victorine et un croate Lucasovic présumé maître logeur de la maison. Mais … chut … la rumeur ….
Le camp des ferrailleurs est né de la sidérurgie, pour y entrer, un retour aux sources s’impose.
La sidérurgie a des exutoires obligés. A la Providence le crassier en assumait une large part.
Dans le haut-fourneau, lorsque la coulée est imminente, il faut éliminer la crasse qui surnage sur la fonte. Il reste cependant des traces de fonte dans le laitier.
L’évacuation de ce laitier se faisait dans d’énormes godets métalliques, appelés poches à laitier.
Tractées sur rail par une locomotive Decauville, les poches et leur contenu se retrouvaient sur le plateau surélevé du crassier, alignées sur le bord d’un plan incliné.
Juché sur le train de roues, à la gauche du redoutable engin, un ouvrier expérimenté, « le culbuteur » assumait la délicate et dangereuse opération de faire basculer la poche sur ses pivots latéraux. Il déclenchait le mécanisme de déversement en manoeuvrant une roue à rayons extérieurs.
Au fur et à mesure de sa lente inclinaison, la poche libérait son contenu liquide. Un large ruban de laitier incandescent fusait et dévalait alors le plan incliné, en serpentant parmi les aspérités laissées par les coulées précédentes.
Parfois, le culbuteur était tenu à jouer les prolongations, un culot de lave chaud mais solidifié restait accroché au fond de la poche.
A l’aide d’une lourde barre d’acier, maniée en bélier, il percutait le fond de la poche suivant un rythme lent. Il sonnait le « glas » et l’effet sonore et sinistre se répandait au dessus du coron, jusqu’à l’intérieur des maisons.
Quand le culot se détachait sous les vibrations initiées par les coups de barre, il déboulait avec fracas sur le plan incliné et formait alors en bas du crassier, avec ses semblables une sorte de « Carnac » aux menhirs décapités.
Le haut-fourneau travaillant en continu, l’évacuation du laitier suivait la production des coulées de fonte.
A chaque vidange de ce laitier, et surtout à la soirée, illuminé, le crassier devenait le théâtre d’un fantastique spectacle avec ses acteurs, une dizaine de personnages en « compétition » se ruant à l’assaut des traînées de lave, attirés par les étincelles décelant la présence de fonte dans le laitier rouge.
Joachim Strobans excellait dans cet exercice dangereux consistant à marquer son territoire … sa prise avec des pointes en acier enfoncées à côté du lacet brûlant. Son équipier Lucas lui … se chargeait d’extirper les filets de fonte du magma refroidi, à l’aide d’une masse et de pinces leviers.
Les bouts de fonte ainsi récupérés étaient vendus au « marchand de mitrailles » qui passait au camp à chaque fin de mois.
Bien sûr, il y avait un chef garde chargé de mettre de l’ordre, de surveiller ce fabuleux chantier. Il fermait les yeux évitant ainsi à se frotter à des gens hors normes.
Le butin du mois est plutôt maigre mais l’ambiance chez les Strobans est à la fête … Il y en a, en perspective, la soirée de ce samedi chez « Pirou ».
A ce stade du récit, il est temps d’entrer dans l’intimité du trio.
Chez les Strobans, la formule « les extrêmes s’attirent », prend figure d’axiome tant le profil de ces personnages diffère.
Joachim est un artiste dilettante. A ses heures, il titille l’accordéon hérité de son père. Homme de gabarit moyen, il paraît frêle …
C’est un faux maigre. Une nonchalance feinte est trahie par des réflexes rapides … imprévisibles. L’onctuosité de sa voix étonne car la bouche aux lèvres minces est dure. Le nez à bout rond donne à l’homme un air faussement débonnaire. Joachim est un être instable, il couve une jalousie maladive mais, comme Saint Thomas, il n’attache d’importance qu’à ce qu’il voit et … il voit assez mal !
Sa femme Victorine … « la Torine » comme on dit chez les ferrailleurs, est un bel animal.
Grande, elle a au naturel cette vulgarité complaisante qui capte l’attention. Coiffée à la garçonne, son front est garni de franges noires qui mettent en valeur des yeux verts un peu glauques. Un nez assez fort, des lèvres charnues renforcent le charme ambigu de la femme.
Plate devant, ronde derrière, Torine a le creux des reins placés haut, ce qui lui donne une singulière silhouette d’échassier.
A la maison, elle est l’élément dominant et le Croate lui aussi se range aux ordres de la patronne sans se poser de question.
Depuis un an, Lucasovic fréquente les Strobans à la satisfaction du couple.
C’est l’émigré qui, comme tant d’autres’ est venu se chercher une petite place au soleil et s’est retrouvé dans le trou noir d’une mine à charbon. Il est grand, un peu fadasse, il est blond et n’a rien de l’oustachi ténébreux des Balkans. Luca ne travaille plus au charbonnage du Bierrau, il touche une pension, suite à la perte d’un œil dans un accident de travail au fond de la mine.
Curieusement, l’œil de verre qui remplace l’absent, paraît plus grand, il est clair et illumine ce visage qui, sans cet artifice, serait des plus communs. L’homme est taiseux, effacé, disponible ;
En cette fin d’après-midi, c’est l’effervescence chez les Strobans ; Ils se préparent car ils sont en représentation, chez « Pirou », pour y mettre l’ambiance comme à chaque soir de paie aux usines du coron.
Joachim, debout sur une chaise, devant la garde robe, attire à lui le « Scaviola », son piano à bretelles rangé sur le meuble. Il le passe à Luca qui dépose l’instrument sur la table. Tiens…. ! Le vieux fusil de chasse qui était allongé derrière l’accordéon a changé de place. Joachim énervé, bouscule une boite de cartouches entrouverte qui atterrit sur le pavement ? Il descend de la chaise, l’arme à la main, la pose contre le mur et du pied repousse les munitions sous le meuble
– Ah ! … cette saleté de pétoire va finir au canal … Torine combien de fois ne t’ai-je dit de ne plus prêter le fusil à ce morveux…
Le morveux, c’était Léon, le fils du voisin qui une fois l’an massacrait la corneille, la poule d’eau le long du canal
– Jo, tu ne fais que râler… il t’a laissé des cartouches et même le billet que voila
– Oui, écrase et dépêche-toi l’heure tourne … on nous attend là-bas.
Torine, comme à l’habitude traîne à plaisir en se maquillant le visage … Que va-t-elle enfiler ? De toute évidence la robe verte en laine … qui lui va si bien.
Joachim s’impatiente ?
– Je ne t’attends pas, j’y vais, ne tarde pas trop.
Il fonce chez « Pirou » escorté par Luca qui brinqueballe l’accordéon pendu à son harnais. L trajet de la maison au « Pirou » n’est pas long et lorsqu’il franchit la porte, Joachim est accueilli comme le messie.
Il y a du monde au café : des gens de la mine, des métallos, des femmes et des plus jeunes qui viennent s’amuser.
Luca lui, ne fera que passer, il boira son verre et s’en ira finir la soirée au phalanstère de la Docherie avec ses compatriotes.
Le patron, ancien pilier de comptoir, moustachu, la cinquantaine avenante prend Joachim à part : « C’est le moment, réveille moi le populo et que la fête commence ».
L’artiste prend place dans un coin sur une estrade basse et attaque la soirée par la marche ouverture de Radio Chatelineau. L’ambiance, de suite, monte d’un cran.
Ah ! Ce café « Pirou » bruyant, enfumé attirant la clientèle comme le ruban gluant de l’attrape mouche. Ce soir, on danse, on trépigne et on boit …
Le musicien s’arrête, le temps d’une pause … la Torine fait son apparition. Elle aime danser et ne s’en prive pas. C’est l’électron libre et Joachim … tolère.
Sur l’air de Frou-Frou elle valse avec un porion qui a la main baladeuse. Elle enchaîne les rumbas, les javas à petits pas en corps à corps.
Joachim à l’arrêt boit son verre, ferme les yeux mais n’en pense pas moins : chauffez … chauffez les boutes feu, la dernière main est toujours pour moi.
Pourtant, ce soir, … il y a un bémol à cette assurance volontariste : le comportement lascif de Torine lorsqu’elle est dans les bras du fils du voisin, ce jeune coq de Léon. Elle s’abandonne et ne danse plus qu’avec lui … Les tangos joue contre joue.
Il se fait tard, l’assemblée devient plus fluide. Léon a filé en douce. Et, bien sûr, Joachim l’a remarqué.
Torine sort de la cuisine du « Pirou » un bout de fromage à la main, elle le refile à son homme et lui dit :
– Je suis fatiguée, j’en ai marre, je rentre …
– Bon dieu, fais un effort … tu sais, je ne suis payé qu’à la fermeture.
Torine n’en a cure, n’en fait qu’à sa tête et quitte le café sans se retourner …. Dehors, c’est la nuit.
A l’intérieur, la soirée se traîne. Joachim accuse la fatigue, il a bu lui aussi, son doigté est devenu hésitant. Ca devient long, au comptoir des clients éméchés s’énervent … Pirou avec diplomatie les dirige vers la sortie. On va fermer et l’artiste a rempli sa mission.
Demain, Luca passera récupérer le « Scaviola ». Pirou est satisfait de la soirée et il rétribue le musicien plus largement que convenu.
On se congratule, on ferme et Joachim est dehors … seul sur le chemin du retour.
D’un pas mal assuré, il se dirige vers la borne fontaine qu’il distingue à peine dans la nuit. Il est à présent dans la cour « del pire » et longe les maisons.
Pas de lumière chez lui, …. Torine est couchée.
Il pousse doucement la porte et abasourdi, dans le noir, il perçoit des chuchotements et autres soupirs qui ne laissent aucun doute sur la nature de ce qui se passe à l’étage …
– Nom de dieu …. Le Léon et ma pute … de femme
Il pousse l’interrupteur, l’ampoule électrique éclaire la pièce, subitement dégrisé, il voit le fusil contre le mur et ramène du pied les cartouches gisant sous le meuble.
En un tour de main, il charge la pétoire et s’élance face à l’escalier, il rate la première marche… et le coup de feu part dans le coin du plafond qui s’éparpille dans un nuage de poussières …
Là haut … on s’agite, c’est le branle bas !
Dans un craquement la fenêtre s’ouvre et un homme se laisse glisser à l’extérieur.
Surexcité, Joachim met du temps à recharger l’arme … furax il se précipite dehors, une silhouette file vers le crassier et se perd dans l’obscurité.
Joachim s’arrête, épaule le fusil, fait feu et vaincu par l’émotion … il tombe à genoux.
Des fenêtres s’éclairent dans la cour. Joachim tout à coup réalise l’ambiguïté de la situation. Il s’éclipse, contourne le bout de la rangée de maisons et rentre chez lui par la porte de derrière, le fusil à la main … ni vu, ni connu.
La maison est vide. Victorine a disparu … Joachim angoissé, épuisé s’effondre sur le divan.
Le sommeil ne vient pas, ce n’est qu’au matin qu’il s’endort profondément.
Il ne se doute pas qu’au dehors de nouvelles péripéties viennent s’ajouter à sa tragi-comédie.
Le chef garde, en ronde matinale, a repéré, au bas du crassier, un corps inanimé, étendu entre deux culs de poches.
Par téléphone, il a alerté le poste de secours des Forges de la Providence. Ordres et recommandations lui ont été fournis : surtout ne touchez à rien, attendez le fourgon ambulance. La police est prévenue.
Intrigué, il est descendu au bas du crassier, s’est approché et reconnu un des ferrailleurs qu’il connaît plus ou moins de vue.
L’homme est à demi dévêtu, il a le visage ensanglanté. La blessure au cuir chevelu est impressionnante. Le chef garde ose le geste de toucher le blessé sous le menton à la gorge et … miracle, le cœur bat … il vit.
Le chef garde court vers la maison la plus proche et après quelques minutes, il en sort une couverture sous le bras.
Le bruit de la découverte a tôt fait de se répandre, les voisins se précipitent au crassier.
Joachim, lui … s’est réveillé. Il a vaguement perçu le passage d’un véhicule dans la cour. Il est vivement ramené à la réalité par le pin-pon du fourgon ambulance qui repasse devant la maison.
Il ouvre la porte et met le nez dehors. Bon sang, que se passe-t-il ? Voici Pétrus, le père de Léon et l’agent de police, Constant qui s’avancent vers lui.
Il panique et en un éclair, il revit les événements tragiques de la soirée.
Devant le vieux Pétrus, il balbutie
– Léon ….
Pétrus sarcastique :
– Léon ! Quoi Léon ! Le « macchabée », c’est ton croate … imbécile !
L’agent Constant
– On peut entrer ?
La conversation s’engage. A première vue, la blessure est due à une chute. Le cul de poche en porte une marque sanglante. Ce qui est à éclairer, c’est la présence de l’homme qui, dévêtu a passé la nuit au crassier.
L’agent Constant :
– Ce croate loge-t-il chez vous ?
Joachim lorgne le pouce que Pétrus vient de se placer devant la bouche.
– Non … il passe … quand il va au crassier, il mange parfois chez nous mais il est domicilié au phalanstère à la Docherie.
– – De toute façon, je reviendrai demain avec le juge, il y aura enquête.
Le juge ne s’est pas déplacé. L’agent Constant a bien essayé de tirer l’affaire au clair mais finalement, il laissa tomber … L’Omerta n’étant pas un vain mot chez ces gens là.
Au bout d’un mois, recousu et remis de sa commotion, Luca quittait l’hôpital et regagnait le phalanstère. Torine, sans complexe, avait repris le contrôle du ménage.
Le calme était revenu au camp des ferrailleurs. Le fusil gisait au fond du canal.
Quant à Joachim qui avait retrouvé ses esprits … il était sans équipier … Léon peut-être ?
Et pourquoi pas la vie …. n’est-elle pas un éternel recommencement ?
Epilogue.
La vieille histoire est terminée, elle date d’une soixantaine d’années. Depuis longtemps le fond de Darmet est mort (Exit le camp des ferrailleurs. Exit le café « Pirou »)
Il a été démantelé, rasé puis remblayé pour cause d’assainissement et d’inondations répétées.
En périphérie, le long du canal, les restes d’une sidérurgie leucémique subsistent encore.
Le terril vert du charbonnage du Bierrau attend son éventration pour qu’on puisse monnayer sa moelle.
Dernier témoin enjambant le canal, le pont de chemin de fer sur lequel plus rien ne passe, est en proie à la rouille.
Et le crassier … Le crassier est l’un des chancres traqués en Wallonie par une écologie bien pensante.
Il dort à l’abri d’une muraille en béton de cinq mètres de hauteur et sur une longueur de deux cents cinquante mètres.
Suite à un accord surprenant, le long mur lépreux a été pris d’assaut par une nuée de « tagueurs », acrobates sur échelles, talentueux et imaginatifs. La laideur a disparu sous une fresque d’une modernité délirante. Situé, rue latérale au bord du canal, cet écran « protecteur » haut en couleurs, vaut le coup d’œil.
Avec une certaine nostalgie, peut-on y voir aussi, un hommage posthume au vieux fond de Darmet disparu dans la nuit des temps.
Le destin d’Adolphe Packant.
A l’arrêt de la Violette, le conducteur du tram freina brusquement. Surpris, je sortis de mon assoupissement. Le manège des voyageurs descendants et montants attira mon attention et, dès qu’il parût à l’entrée du compartiment … je reconnus Adolphe.
Nos regards se croisèrent sans plus.
Une petite femme de stature frêle l’accompagnait. Ils prirent place à la banquette précédant la mienne.
Derrière le dos de l’homme, je pensai en souriant à ce facétieux destin qui agence comme à plaisir les rencontres improbables.
Arrivé à destination, le couple se leva, à ce moment, inconsciemment, dans un souffle le prénom me vint aux lèvres … la femme tourna légèrement la tête, Adolphe lui … ne broncha pas.
Ils descendirent du tram, je pus les suivre du regard un court instant.
J’avais reconnu Adolphe, à sa face de pierrot lunaire mais je restai ébahi par le changement physique du personnage.
Ce n’était plus mon ami d’enfance, ce gamin estropié, boitant bas, mais un homme élégant qu’une légère claudication à la jambe gauche ne semblait guère affecter.
A ce moment du récit, Pierre Mose s’arrêta. Je connaissais Pierre depuis quelques années, une passion commune, la peinture, nous avait réunis. Il nous proposa une bière, nous la bûmes en silence et mon compagnon, de sa voix grave, reprit le fil de l’histoire.
C’était, dit-il, en 1936. J’avais dix ans quand je fus confié à mes grands parents : les Mose. Je découvris ce bout de rue de Marchienne qui s’étranglait sous la voûte en briques du pont Bierrau et cette petite esplanade en terre battue, au bord de laquelle se trouvaient en perpendiculaires et la maison des Packants et celle des Mose, mes grands parents.
Les Packant étaient cinq. Ils semblaient sortis d’un roman de Zola.
L’homme et la femme passaient des heures au café tout proche laissant les enfants seuls à la maison.
Les personnages de cette famille avaient de curieuses particularités.
Le chef de famille, Camille petit homme ombrageux, mineur de fond, pensionné dès ses quarante ans, souffrait d’une silicose profonde. Il était père de deux enfants nés d’un premier mariage : Odette une gamine d’une douzaine d’années et Benjamin, un bambin de trois ans.
Sa seconde femme, Bertha, de nationalité allemande et mère d’Adolphe, s’étirait en maigreur. C’était une femme chétive, au regard fuyant, amorphe et sans personnalité ?
Né de père inconnu, Adolphe, âgé de neuf ans, était le mouton noir chez les Packant.
Quand Camille Packant épousa la mère, il eût le geste « noble » de reconnaître Adolphe qui devint un Packant par la tangente ce qui ne l’empêcha nullement d’encaisser brimades et rebuffades tout au long de son enfance, de son adolescence.
Adolphe était un gamin attachant. Son visage au teint pâle et ses yeux sombres attiraient l’attention mais, le regard posé sur sa personne descendait inévitablement sur la malformité du pied gauche qui l’affligeait depuis sa naissance ?
Ce pied était tordu, recroquevillé vers le bas. Chaussé d’une semelle en caoutchouc qui épousait la difformité, Adolphe se déplaçait en boitillant avec l’agilité d’un chat.
Pierre Mose me sembla rêver un moment. Il venait, me dit-il, d’avoir à l’esprit cette anecdote au comportement aberrant d’Adolphe et il enchaîna … Par un bel après-midi, alors que les parents passaient leur ennui au bistrot, Adolphe entreprit une folle cavalcade. Juché sur le landau de Benjamin, il se faisait catapulter de l’intérieur de la maison par sa sœur Odette et franchissait d’une envolée les deux marches en pierre de la maison.
La deuxième course finit mal, l’arrière de l’engin heurta la marche du bas de l’escalier. Adolphe roula dans la poussière et se releva en riant. Hélas une roue du landau se trouvait en mauvais état.
Odette avoua l’origine du drame et le père à moitié ivre corrigea brutalement le cascadeur en herbe.
Pierre Mose entra de plein pied avec Adolphe dans l’épopée des jeux interdits. Au coron, les premières grandes vacances furent un remake, version darmetoise, du Grand Meaulnes d’Alain Fournier : nouveaux compagnons de jeux, environnement sauvage, terril, canal, rivière, sources d’évasions exploitées en liberté si peu surveillée.
C’était pour les enfants le côté magique du miroir.
Par contre, les habitants du coron avaient à faire face aux dures réalités de l’époque, au chômage engendré par la crise industrielle des années trente.
Le grapillage du charbon, les mitrailles sur le terril et crassier, atténuait un tant soit peu la misère ambiante.
Pierre alluma une cigarette, en aspira profondément la fumée, la projeta vers le plafond et … remit le récit en marche tel un bon vieux CD sur sa console. C’est ainsi que trois années s’écoulèrent pour moi dans l’insouciance la plus complète.
Nous avions grandi et le long pantalon d’Adolphe cachait mal le pied emprisonné dans son éternelle chaussure en latex.
A ce moment de l’histoire, Pierre Mose ne put s’empêcher de faire une remarque sur l’apathie de l’entourage d’Adolphe. Le grand gamin vivant son infortune dans l’indifférence générale : uns disgrâce physique et morale que le temps allait inexorablement amplifier.
En 1939, reprit-il, des rumeurs inquiétantes circulaient dans l’Europe entière.
Au coron, dans un calme relatif, un camion militaire avait débarqué quelques soldats réservistes. Une parade d’opérette occupait le pont sur le canal.
Mais, le 10 mai 40, la grande catastrophe s »abattit sur la Belgique. L’Allemagne envahit le pays et déclencha le bouleversement total et les misères en tous genres.
Pierre quitta la chère maison des Mose et regagna celle de ses parents située bien au delà du pont du Bierrau. Il perdit tout contact avec Adolphe et il poursuivit tant bien que mal des études perturbées à l’école industrielle de la ville.
Pierre Mose s’arrêta un moment, réactiva le feu, se passa la main sur le front et reprit la parole : Ces années de guerre furent pour tous une longue et dure épreuve.
J’avais vingt ans, dit-il, à la libération j’en avais trente quand je revis Adolphe dans l’épisode du tram à l’arrêt de la Violette. Je crois qu’à cette occasion, il m’avait délibérément ignoré.
Il n’en fut plus de même lorsque je le rencontrai quelques années plus tard pour la deuxième fois.
Je m’étais rendu à la maison des Notaires pour des renseignements relatifs à une question de voisinage.
Passant à la hauteur du café « Au testament » tout proche, j’aperçus Adolphe attablé à la terrasse. A ma surprise, il se leva en souriant et m’invita à prendre un verre à sa table.
– Tu attendais quelqu’un lui dis-je
– Non Pierre, je viens de régler une affaire, j’ai tout mon temps et j’espère qu’il en est de même pour toi.
Il appela le garçon, me demanda ce qu’il me plairait de boire et passa commande.
Je l’observai, il était bel homme. Ses traits s’étaient affirmés, et la pâleur du visage et l’éclat de ses yeux sombres restaient les points forts de sa personnalité.
Il avait une facilité de parole surprenante et sa tenue vestimentaire donnait de lui, l’image du parfait fonctionnaire et tout naturellement, je le félicitai pour sa bonne mine.
Emus, nous restâmes un moment sans voix … Il lisait certainement dans mes pensées car brisant le silence devenu gênant il proposa tout de go : Et si nous en venions à la question qui te brûle les lèvres … »Et le pied ?» Il ajouta, en forme de boutade, c’est la partie de l’iceberg cachée sous la table et brusquement, pivotant sur sa chaise, il sortit de l’ombre deux pieds chaussés à l’identique.
Tu sais, me dit-il, je ne parle jamais de cette période noire de la guerre, de ses misères, de ses malheurs et pourtant, je lui dois les circonstances peu banales qui me permettent aujourd’hui de vivre dans la normalité.
Deux ans après la déclaration de guerre, mon beau-père Camille décéda dans des conditions pénibles, terrassé par la silicose qui l’accablait depuis longtemps. A la maison, notre situation devint catastrophique. Dans la misère, avec les enfants à charge, ma mère acquit une force de caractère qui la transforma en battante. Nationalité allemande aidant, elle trouva un emploi de femme de charge à l’hôpital de la ville réquisitionné par l’armée allemande. Cela permit d’améliorer quelque peu une situation difficile.
Ce fut mal vu au coron, une pétition circula à la libération, elle resta sans suite.
J’allais souvent rechercher ma mère à l’hôpital après son travail.
Un jour que je l’attendais au sous-sol, elle m’appela dans la salle des plâtres qu’elle venait de ranger.
Elle tenait à la main une petite mallette en cuir, une sorte de porte documents, qu’elle venait de découvrir dans une poubelle.
Nous prîmes l’ascenseur pour gagner le secrétariat où la vue de la mallette fit l’effet d’une bombe. On la cherchait depuis deux jours. La secrétaire donna un coup de fil et nous fit asseoir. L’attente fut brève et la porte s’ouvrit sur un personnage en blouse blanche, un petit homme à moustache (C’était, nous l’apprîmes plus tard le médecin Major Heer Schutzman)
Il prit possession de la mallette, l’ouvrit, passa ses doigts entre les feuillets et parut rassuré.
Il s’entretint en allemand avec la secrétaire qui nous désigna du doigt. Nous étions assis sur le banc au fond de la pièce. Il s’approcha, nous regarda de plus près et naturellement mon pied emmitouflé qui dépassait la jambe de mon pantalon l’intrigua.
« Wast ist das ? » s’exclama-t-il il répéta en français « Qu’est ce que c’est ?
Je déballai mon pied, il haussa les sourcils et me demanda mon nom, je déclinai Packant Adolphe. Il eut un léger sourire et avec sa mallette sous le bras, il sortit en silence du secrétariat. La secrétaire enregistra la déclaration que fit ma mère sur les circonstances de la trouvaille de la mallette et lui fit signer le document. Quand nous sortîmes de la pièce, ce fut pour nous comme un soulagement … une sorte de libération.
Adolphe souffla un moment, son long monologue l’avait assoiffé. Les verres étant vides, il les fit remplir avec autorité et continua l’étrange histoire :
« Un mois plus tard, à notre grande surprise, nous fûmes convoqués, ma mère et moi, au service de chirurgie du Docteur Schutzman. Il eut avec ma mère une longue conversation en allemand où furent envisagées les possibilités réductrices de la malformation de mon pied. Quand elle lui parla de notre situation pécuniaire, le Docteur haussa les épaules et balaya d’un revers de la main tout forme d’inquiétude. L’occasion était inespérée mais l’idée de l’opération nous paralysait.
J’avais 16 ans et ma mère me laissa décider seul. La date fut fixée et après de multiples examens radiographiques et autres paramètres qu’il tenait à considérer, le chirurgien Herr Schutzman m’opéra. Une opération qui allait bouleverser ma manière d’être, ma manière de vivre.
Adolphe ne me révéla ni la forme, ni l’importance de l’opération. Je me gardai bien de lui poser des questions indiscrètes ou stupides.
Les rééducations du pied et de la jambe furent longues et pénibles et la délivrance de ses maux coïncida avec la fin de la guerre.
Il est rare me dit Pierre Mose que le destin accorde par deux fois ses faveurs et pourtant, Adolphe en fit l’heureuse expérience.
Pierre se fit à nouveau l’interprète d’Adolphe et il me rapporta avec un plaisir évident les dernières tribulations rédemptrices que son ami remit sur pied lui avait confiées.
Pour ce dernier, il ne fut pas simple de vivre sa nouvelle « naissance ». Il avait tant à coeur d’aider sa famille. Comme tout un chacun, ce fut difficile de trouver une occupation lucrative. Il entreprit divers petits boulots bien mal rétribués et … le temps passa avec son lot de difficultés. Un jour, sa sœur Odette fit la connaissance d’un chiffonnier ferrailleur, veuf et plus âgé qu’elle. L’homme possédait la charrette et le cheval, il embarqua Odette, la mère Bertha et Benjamin dans sa petite entreprise qui doucement prenait forme. Odette aussi avait pris forme. Adolphe, lui, ne suivit pas l’exode. Il choisit la liberté. Il avait trouvé un emploi de garçon en « extra » dans un grand café de la ville.
Un soir, dans la file d’attente d’un cinéma, il fit la connaissance d’une petite nièce éloignée du notaire Noirsec. L’idylle devint sérieuse et un an plus tard, un mariage s’en suivit dans l’intimité. Sa femme, employée traductrice assuma un premier temps les besoins du ménage.
A l’instigation du notaire Noirsec, Adolphe prit des cours de comptabilité par correspondance et d ès qu’il eut acquis certaines notions élémentaires de commerce, Maître Noirsec le dota d’une semi fonction de clerc .
Il travaillait en extérieur de l’étude, répertoriait les articles issus de faillite, s’occupait même parfois de « certaines ventes ». Il acquit de la sorte un salaire qui permit au couple de vivre très honorablement.
Suite au long exposé de son ami, Pierre Mose me fit part des réflexions échangées avec ce dernier.
Le destin d’Adolphe est le fruit de rencontre d’exception. Certes, sa réussite professionnelle est due au fait d’avoir rencontré une femme remarquable par ricochet, Maître Noirsec qui le prit généreusement sous son aile. Mais que penser de la rencontre qu’il fit avec l’étonnant docteur Schutzman, cet homme providentiel et son incroyable prise en charge du cas de pathologie externe du pied d’Adolphe.
Ce don du ciel était-il du simplement à la récupération des fameux papiers ?
Mystère … Nul autre que le docteur Schutzman n’en saura rien !
Adolphe m’affirma n’avoir jamais eu le moindre état d’âme sur ses rapports et ceux de sa mère avec l’occupant.
Un peu plus tard, grâce à ses relations, il put consulter la liste de signatures sur la pétition qui avait circuler au coron à la libération : les voisins Desmet, Comen, Demesse y figuraient, celle du vieux Mose n’y était pas.
C’est sur ces considérations que Pierre Mose tire le rideau sur les facettes du curieux destin d’Adolphe.
Nous nous séparâmes dit-il la tête pleine de souvenirs remémorés et, avec la promesse de nous revoir. Cela resta sans suite, pourquoi ?
La pénombre avait envahit la pièce où il me parlait d’Adolphe depuis près d’une heure.
Son chien un grand boxer noir, qui somnolait près du feu s’étira et alla gratter la porte.
Pierre m’invita à prendre l’air, nous revêtîmes nos parkas et sortîmes avec le chien.
Nous avions à peine fait quelques pas sur le chemin de hallage du canal quand, dans un fracas assourdissant, la cokerie des hauts-fourneaux de la Providence libéra son panache de fumée blanche.
Je regardai Pierre Mose … foutu patelin hasardais-je !
Oui … mais tellement attachant me répondit mon ami avec un soupçon de mélancolie dans la voix.
Dampremy, le 20 novembre 2008